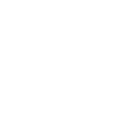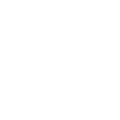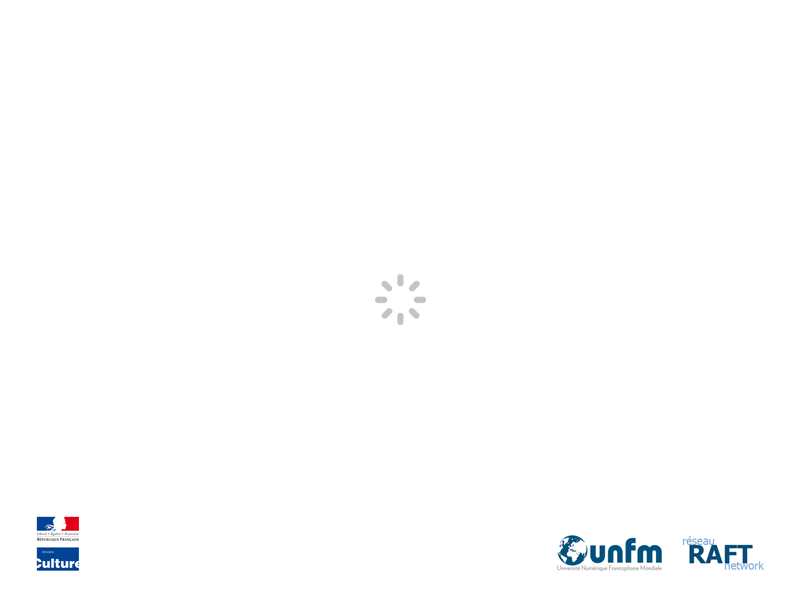Vincent NÉGRI, chercheur au CNRS (Centre d’études et de coopérations juridiques internationales) En droit international, l’économie normative de la protection du patrimoine culturel est polarisée sur l’intérêt général de l’humanité à préserver des valeurs universelles – mondiales – ou régionales – continentales – promues par une communauté internationale, afin d’assurer une diversité culturelle, de prévenir les risques de dénaturation, de dispersion ou de disparition d’un patrimoine national ou supranational, et de diffuser les ferments d’une culture plurielle commune. Ce triple objectif développe une responsabilité collective des Etats qui les engage sur le fondement du principe de réciprocité – principe éventuellement aménagé par leurs responsabilités différenciées – et déploie des obligations individuelles des Etats, de protection et de conservation de leur patrimoine national. Un tel processus caractérise non seulement la prévention du trafic illicite et les mécanismes de retour des biens culturels, mais également la protection des biens culturels lors des conflits armés ou encore la protection du patrimoine mondial de l’humanité. Dans une autre voie, les codes de déontologie adoptés par des organisations internationales, relayés par des chartes sectorielles posant les principes d’interventions sur certaines catégories de biens culturels, peuvent renforcer l’effectivité du droit international en adjoignant à l’engagement d’Etats parties aux traités internationaux, l’adhésion des corps professionnels investis dans la conservation du patrimoine.